Kim Hafez 4 années dans le Grand Nord
UN HOMME, UN CHIEN-LOUP
Quatre années d’aventures dans le Grand Nord
Première partie du récit. Celle-ci a été publiée dans Carnets d'Expé n°4 (qui est épuisé), la suite dans Carnets d'Expé n°5 (voir le sommaire ; pour le commander clicker ici)
Texte et photos de Kim Hafez
Cet article tel qu'il est paru dans Carnets d'Expé n°4 est disponible en PDF (cliquez bouton droit et "enregistrez cible sous" pour le télécharger sur votre ordinateur).
Bientôt plus de photos de cet article !!
Au passage, nous vous recommandons vivement la lecture des 2 ouvrages de Kim Hafez :
- Unghalak, la quête sauvage (ed Transboréal ; voir notre avis sur ce livre) qui raconte un premier long voyage en canoë au Canada
Nomade du Grand Nord (ed Transboréal ; voir notre avis sur ce livre) qui raconte cette aventure de 4 années dans le Grand Nord en kayak de mer, en compagnie du chien esquimau Unghalak.
Au commencement, un rêve
Un rêve vieux comme l’humanité que l’on a tous enfoui quelque part en soi, certains moins profondément que d’autres naturellement. Je désirais faire le tour du monde. Du moins était-ce le prétexte que je donnais à mes proches pour justifier mon départ, car, secrètement, je rêvais plutôt d'une vie de voyageur, une sorte de tour du monde sans fin, sans but. Je ne voulais plus d’une aventure aseptisée, comme celles que j’avais déjà vécues. Je ne m’imposais donc pas de destination, pas de limite dans le temps, désirant ainsi poursuivre l’expérience jusqu’au bout. Et voir où elle me conduirait.
Comme moyen de déplacement, je choisissais cette fois le kayak de mer. L’autonomie que m’offraient ses compartiments étanches permettait de naviguer dans n’importe quelle région du monde, jusqu’aux plus reculées et, grâce à un chariot flottant en acier inoxydable fait sur mesure et quelques chambres à air de secours, il était même envisageable de traverser à pied, kayak en remorque, tout un continent. Un éventail de possibilités m’était donc offert et, pour être franc, je crois que j’étais ouvert à toutes. La première étape de mon nomadisme serait le cap Nord, extrémité septentrionale de la Norvège continentale. Après, la logique suggérerait une incursion en Sibérie, mais elle était si loin que c’était illusoire de s’en préoccuper déjà. De la péninsule du Kamtchatka, je pourrais toujours essayer de gagner l’Alaska, puis le Canada et le Groenland… Un rêve n’a pas d’horizon.
Au commencement, un rêve
Un rêve vieux comme l’humanité que l’on a tous enfoui quelque part en soi, certains moins profondément que d’autres naturellement. Je désirais faire le tour du monde. Du moins était-ce le prétexte que je donnais à mes proches pour justifier mon départ, car, secrètement, je rêvais plutôt d'une vie de voyageur, une sorte de tour du monde sans fin, sans but. Je ne voulais plus d’une aventure aseptisée, comme celles que j’avais déjà vécues. Je ne m’imposais donc pas de destination, pas de limite dans le temps, désirant ainsi poursuivre l’expérience jusqu’au bout. Et voir où elle me conduirait.
Comme moyen de déplacement, je choisissais cette fois le kayak de mer. L’autonomie que m’offraient ses compartiments étanches permettait de naviguer dans n’importe quelle région du monde, jusqu’aux plus reculées et, grâce à un chariot flottant en acier inoxydable fait sur mesure et quelques chambres à air de secours, il était même envisageable de traverser à pied, kayak en remorque, tout un continent. Un éventail de possibilités m’était donc offert et, pour être franc, je crois que j’étais ouvert à toutes. La première étape de mon nomadisme serait le cap Nord, extrémité septentrionale de la Norvège continentale. Après, la logique suggérerait une incursion en Sibérie, mais elle était si loin que c’était illusoire de s’en préoccuper déjà. De la péninsule du Kamtchatka, je pourrais toujours essayer de gagner l’Alaska, puis le Canada et le Groenland… Un rêve n’a pas d’horizon.
La préparation
C’est très simple : il faut essayer de penser à tout. Avant mon départ, je pris donc rendez-vous chez le chirurgien pour une appendicectomie et chez le dentiste pour me faire arracher une dent de sagesse qui ne présageait rien de bon. Je m’injectai également une dernière dose de vaccin contre la rage. Et voilà, j’étais fin prêt.
Quand ça vous "prend par la peau des fesses"…
Mon long périple en kayak de mer commença le 19 mars 2000, dans une bourgade de l’Essonne, là même où j’avais posé mon sac en revenant du Canada il y avait deux ans de cela jour pour jour : deux années pour chercher un boulot d’ingénieur, changer d’avis après en avoir trouver un, écrire un livre, le voir publié, en vendre quelques-uns et m’organiser pour repartir.
En remorquant mon kayak avec l’aide d’Unghalak (car il nous fallait d’abord atteindre la Seine), encouragés par tous les copains qui s’étaient attroupés autour de notre attelage, un tas de questions surgissaient dans ma tête, comme si à la dernière minute je remettais en cause une décision longuement réfléchie. Si pour une fois c’était les autres qui avaient raison ? On m’avait certifié que je n’arriverais pas à faire 5 milles une fois en mer, chargé comme je l’étais, sans parler du chien et de ma complète inexpérience du kayak de mer. Seule une chose était évidente ce matin-là : c’était en partant que j’aurais une chance de trouver des réponses. De toute façon, il était trop tard pour faire marche arrière, même si ma petite sœur de 13 ans se mit à sangloter dans mes bras lorsque j’étais prêt à embarquer. Elle ne comprenait pas. Elle ne voulait pas comprendre. Etait-elle trop jeune pour savoir que je devais partir ? J’étais fait pour voyager comme certains sont faits pour être guide de haute montagne, moine ou coureur de fond. Tôt ou tard, ça vous prend par la peau des fesses et ça vous met sur le Chemin que l’On a tracé pour vous. C’est comme ça, il n’y a pas grand-chose à y faire et, croyez-moi sur parole, c’est formidable.
La Manche : un vrai cauchemar !
Je pagayais un biplace renforcé de tous côtés avec un pont rehaussé de plusieurs centimètres pour augmenter le volume de chargement, soit une charge totale, en rajoutant ma masse et celle de mon chien, de plus de 320 kg. Que j’étais évidemment seul à propulser. Je transportais entre autres 50 kg de nourriture, soit 5 semaines pour deux, tout le matériel de réparation et de secours nécessaire à un voyage au long cours ainsi que l’équipement d’hiver car, à - 40°C, il ne s’agit pas d’improviser. C’est sans doute pourquoi mon poignet droit, à force de pagayer avec les pelles à 90 ° pour réduire leur résistance au vent, me lança dès les premiers jours. Douleur que je mis sur le compte de mon manque d’entraînement : je ne totalisais en effet qu’une trentaine de minutes au compteur de ma pagaie double avant le grand jour.
Cependant, je finis par contracter une sérieuse tendinite qui m’empêchait de tirer sur la pagaie plus de cinq minutes à la fois. Je ne parvenais bientôt même plus à me brosser les dents avec la main droite tant mon poignet me faisait souffrir. Par ailleurs, la navigation sur la Manche au mois d’avril fut un vrai cauchemar : un naufrage, de la casse, un abandon de plusieurs jours… les épreuves se succédaient, qui me firent perdre toute la confiance — peut-être excessive — que j’avais en moi. Le meilleur moment de ma journée demeurait le soir, lorsque je pouvais enfin me réfugier dans le duvet, fermer les yeux et oublier pour quelques heures le cauchemar dans lequel je m’étais fourré. Chaque minute sur l’eau était devenue une minute d’angoisse, même par beau temps : les courants se moquent bien du ciel. Souvent, avant de m’endormir, je lisais un passage de l’Ancien Testament, retenant l’honneur et le courage d’hommes ordinaires et la devise : « Sois fort et tiens bon » queje tentais désespérément de faire mienne. J’essayais simplement d’avoir assez de force pour me dire que j’irais où Dieu me conduirait, et d’avoir assez de foi pour y croire.
En mer du Nord
Unghalak faisait preuve d’une vaillance exceptionnelle. Lorsque je chargeais le kayak le matin, il s’éloignait souvent, espérant retarder l’heure du départ, ou peut-être carrément l’annuler pour la journée. Il fallait le comprendre : même lorsque la mer était calme, le ressac déferlait avec un boucan à faire fuir tout chien de traîneau qui se respecte et "passer la barre" signifiait pour lui se prendre trois ou quatre bons rouleaux dans les dents, alors lorsqu’on ajoutait à cela un ciel noir ou du brouillard, du crachin et parfois un bon petit vent… il y avait de quoi alimenter nos coupes respectives de peurs. Pourtant, lorsque j’étais enfin prêt à mettre le kayak à l’eau, il n’hésitait jamais à gagner son poste d’équipage : tremblant de peur, il bondissait dans son cockpit, me donnant une des plus belles leçons de courage et de fidélité que l’on puisse donner. Sacré P’tit gars.
À Bray-Dunes, patelin à quelques centaines de mètres de la frontière belge où je liquidais mes derniers francs, j’eus la visite de mon père, de ma p’tite sœur, d’Emeric Fisset (le gérant de la maison d’édition Transboréal) et de Yannick Michelat, armé de sa nouvelle caméra, qui se lançait dans l’industrie du film. Si j’étais arrivé jusque-là, c’est que désormais tout était possible, et eux comme moi savions que nous ne nous reverrions pas avant plusieurs années. J’étais bel et bien entré dans ma vie de nomade au long cours, naviguant sous les étoiles du ciel à la grâce du Très-Haut. J’étais toutefois conscient que la partie ne faisait que commencer et que j’étais à la merci de la moindre erreur de jugement, car la mer ne me pardonnerait plus. Elle l’avait déjà assez fait. Je demeurais donc modeste dans mes ambitions comme dans mon optimisme. Je me rationnais aussi bien en vivres qu’en confiance regagnée. Il fallait mériter les choses peu à peu. Et c’est peut-être aussi pourquoi je préférai gagner mon duvet à l’heure habituelle plutôt que de me rendre à une friterie avec ceux qui étaient venus me rejoindre pour une dernière interview, un dernier encouragement, un dernier adieu. Je me sentais par ailleurs tellement décalé par rapport au monde dont ils surgissaient si soudainement que je ne souhaitais pas me joindre à leur veillée. Je regrette aujourd’hui le manque d’enthousiasme dont j’ai fait preuve ce soir-là, mais j’étais bien incapable de partager ce que je venais de vivre tant mon cœur était encore éprouvé, persuadé que de toute façon ils n’auraient pas pu comprendre.
Le franchissement de la digue de Bruges, le 6 mai, en plein orage, fut la dernière épreuve de ce houleux départ. Pendant une vingtaine de minutes, nous fûmes en permanence balayés par des déferlantes qui surgissaient dans tous les sens. Unghalak, trempé, encaissa sans broncher, tandis que je prenais presque un malin plaisir à traverser cette portion de mer chaotique. Après, à l’abri du large dans les vastes estuaires de Hollande, sous la pluie d’éclairs qui s’abattait tout autour de moi, parfois si dense que j’en étais aveuglé, je riais aux éclatstant j’étais soulagé de quitter la mer du Nord. J'avais réussi à contenir l’effroi qu’elle et la Manche m’avaient inspiré. La foudre aurait tout aussi bien pu s’abattre devant mon étrave que je n’y aurais pas prêté plus d’attention.
Malgré une progression sans histoire jusqu’au canal de Kiel, le moral restait encore en dessous de la moyenne. Je pensais trop souvent à tout le chemin qu’il me restait à faire pour atteindre le cap Nord, qui semblait de plus en plus inaccessible, et je me souciais chaque jour beaucoup trop de choses terre à terre comme dénicher un endroit où passer la nuit, capturer un rayon de soleil pour faire sécher ma tente et mon duvet, avoir suffisamment d’eau douce pour laver mon caleçon et trouver près de la côte une poste où envoyer mes cartes postales ou une épicerie pour me ravitailler. Je m’inquiétais aussi en songeant à l’hiver, bien que ce ne fût même pas encore l’été, et au passage de certaines frontières avec P’tit gars. L’idée d’un retour possible — comprenez par là un retour au monde que j’étais en train de quitter — me mettait franchement mal à l’aise. À moins que ce voyage n’en finît pas, ou finît tragiquement. Les questions tourbillonnaient une fois de plus dans ma tête. Je n’étais sûr de rien et, au lieu de trouver des réponses à mesure de mes coups de pagaie, je me heurtais à un mur d’incertitude qui semblait à présent s’élever jusqu’au ciel. Même si je voulais réellement parvenir à vivre une vie de voyageur au jour le jour, sans me soucier du lendemain, c’était difficile de s’affranchir d’une certaine éducation et de remettre en question la façon de penser qui fait figure de référence dans la société dans laquelle on a grandi.
En mer Baltique
Plages de galets et plages de sable alternaient le long des côtes danoises, désertes le plus souvent. À terre, lorsqu’il faisait beau, je vivais tout nu. J’aimais sentir le contact direct du vent et du soleil sur ma peau. Cette communion naturelle avec la Terre était devenue, au fil de mes différents séjours en milieu sauvage, indispensable à mon équilibre et à mon épanouissement. Vivre à poil a aussi ses avantages : j’en profitais pour régulièrement plonger dans la mer et me débarrasser de la crasse accumulée. J’aimais me baigner dans l’eau froide lorsque les lueurs crépusculaires embrasaient l’horizon, sans m’y éterniser toutefois pour ne pas prendre le risque de me faire bouffer les orteils par des crabes et le reste par des méduses.
J’avais beaucoup moins peur quand le ciel était dégagé : sur la côte est de la Suède, même lorsque la mer me bousculait dans tous les sens ou lorsque le kayak partait en surf et que nous nous retrouvions en partie submergés, le beau temps me rassurait. Pourtant, si nous chavirions loin des côtes dans ces eaux qui étaient de plus en plus froides à mesure que nous gagnions en latitude, je ne donnerais pas cher de nos peaux. Cependant, le soleil brillait, les anges du ciel veillaient, je me sentais en harmonie avec la mer et j’étais sûr qu’il ne nous arriverait rien. Je me sentais bien. Intérieurement du moins. Car j’avais souvent les fesses trempées, la moitié de mon corps glacée par le vent et au moins une oreille complètement bouchée par les embruns. Quand Unghalak tremblait un peu, je le rassurais du mieux que je pouvais. Lorsqu’il se prenait un paquet de mer dans les dents, il tournait sa tête dans ma direction l’air de dire : « Tu l’as fait exprès ou quoi ? » ou « Tu l’as vu ? Tu l’as vu cette vague ? ».
J’eus droit à plusieurs coups de vent sur la Baltique. Parfois sous le soleil, parfois sous une pluie d’éclairs. J’étais de toute façon trop fatigué pour avoir peur. Je crois que mon état physique s’était dégradé au point d’altérer mon jugement. Même en augmentant mes rations, je ne parvenais pas à retrouver mon énergie. Le 19 août, je calculais que j’avais parcouru 4000 km depuis Paris. C’est-à-dire en cinq mois. C’était beaucoup.
Enfin dans la peau d’un voyageur
Puis, vint le mois de septembre. J’aimais cette saison entre été et hiver. On ne pouvait raisonnablement pas parler d’automne sous ces latitudes, car soit l’été se prolongeait en été indien, soit l’hiver arrivait plus tôt que prévu. C’était juste un court répit avant la saison froide, un été qui s’éteignait. J’aimais ces fraîches journées où l’humidité et la nuit tombaient tôt, chassant les tics, les moustiques et les touristes, mais où le soleil réchauffait encore la terre autant que ses rayons obliques le permettaient. D’ailleurs, j’avais le sentiment d’avoir enfin retrouvé, après des mois de navigation difficile, mes sensations d’homme libre, appréciant la rudesse de la vie sauvage. J’étais heureux de vivre. Heureux de respirer à plein poumon le parfum de la mer. Tout simplement heureux d’être là, sans avoir à me justifier de quoi que ce fût. J’étais enfin devenu ce que je voulais devenir : un voyageur. Moi qui ne songeais qu’à abandonner au cours des premières semaines, je voulais désormais que ce voyage fût sans fin.
Laponie finlandaise
Le 15 septembre, j’entamais la remontée du fleuve Kemi, soulagé, je devais bien l’avouer, d’en avoir fini avec la mer et, une fois Rovaniemi dans mon dos, je continuais à faire route au nord en remontant la rivière Ounasjoki, tantôt à la pagaie, tantôt en remorquant mon kayak dans les rapides, sous les premiers flocons de neige de l’année. Lorsqu’un vieux Sami me fit signe du bord, je m’approchai pour voir ce qu’il me voulait (les ancêtres des Sami sont appelés Lapons dans l’ancien langage officiel : par Lapon, on entendait en Finlande une personne qui exerçait comme principal moyen de subsistance l’élevage des rennes, la pêche et la chasse). Il se demandait en fait ce que je portais aux pieds pour marcher ainsi avec de l’eau jusqu’aux cuisses. "Des sandales !" lui répondis-je en soulevant un pied, puisque nous ne communiquions essentiellement par signe — mon finlandais n’était pas encore au point. J’en profitais pour lui demander comment était la rivière en amont des rapides et devinais, d’après son charabia et ses grimaces, que cela deviendrait de mal en pis. Il était temps de voir ce que mon chariot valait vraiment. Je n’étais d’ailleurs pas mécontent de mettre la pagaie de côté pour marcher un peu. Je me trouvais à 500 km à vol d’oiseau au sud de la mer de Barents, c’était largement de quoi me dégourdir un peu les jambes. De la mer de Barents, j’avais finalement décidé de rejoindre la mer de Norvège en franchissant le cap Nord. Pas avant le printemps 2001 toutefois : même si la forêt nous soustrayait en partie du vent et que, de fait, il faisait en apparence plus doux, l’hiver ne tarderait en effet guère à s’installer pour de bon. Je n’avais pas la moindre idée de l’endroit où je le passerais et, d’ailleurs, je m’en fichais complètement.
Je découvrais le bonheur, après toute une journée de marche, d’ôter mes godillots pour enfiler les sandales et laisser mes pieds respirer, même lorsqu’il neigeait un peu. J’étais également heureux de rester au sec dans des vêtements autrement plus confortables qu’une veste et un pantalon de kayak étanche en Cordura. Comme le bois mort abondait, je passais de longs moments à rêvasser devant mon feu de camp. J’écoutais distraitement les bûches siffler en se vidant de leur humidité, la clochette d’Unghalak résonner dans le sous-bois lorsqu’il courait après quelque écureuil, ou encore les geais de Sibérie qui piaillaient de loin en loin, seuls sons dans ce monde parfaitement silencieux.
Nous pénétrions bientôt dans une région beaucoup plus sauvage où la piste qui filait vers le nord, n’était plus qu’une simple tranchée creusée à travers les conifères. N’y résonnaient, dans le silence religieux de la forêt boréale, que le martèlement de nos pas et l’écho de nos chants. Unghalak avait les coussinets à vif et la marque du harnais gravée sur la peau à force de tirer, et moi des cloques sanguinolentes aux talons, de taille comparable à celle des trous dans mes chaussettes. Nous poursuivions cependant notre route vers le septentrion, bien au-delà du cercle polaire, au rythme d’une vingtaine de kilomètres par jour.
Premier hivernage (Laponie finlandaise)
Huit mois après avoir quitté Paris, je trouvais un emploi dans une ferme à chiens de traîneaux. Il faut dire que les gars de la région d’Ivalo m’avaient bien aidé dans ma recherche d’emploi et que le bouche à oreille lapon marchait admirablement bien dans ces pays qui étaient quasiment inhabités en dehors des saisons touristiques. On m’offrait de passer l’hiver dans une cabane en rondins sans électricité ni eau courante, dans les bois, au milieu de 150 huskies de Sibérie. Un poêle à bois, modèle Klondike, une lampe à huile et quelques bougies la rendait vivable. "Le dernier guide y a vécu pendant deux ans", me dit-on, pour me convaincre que ma nouvelle demeure n’était pas aussi mauvaise qu’elle en avait l’air. Un lit, une table, une chaise occupaient presque tout l’espace qu’elle offrait. De toute façon, je ne trouvais aucun mal à y ranger mes maigres possessions et signais, après quelques jours d’essai sur la ferme, un contrat jusqu’au 1er mai 2001.
Au Finnmark
Le 30 avril 2001, nous étions à nouveau en route, attelés au kayak puisqu’il fallait encore marcher avant d’atteindre un cours d’eau qui se jetait dans la mer de Barents. Le fleuve Tana nous permettrait de franchir la frontière norvégienne à la pagaie, donc ni vu ni connu (fusil de chasse et chien obligeaient). Ainsi, la planimétrie était en notre faveur. Pas le nivellement. Le paysage se vallonnait davantage et, pendant les descentes, je souffrais horriblement des genoux. J’avais si mal que la douleur me réveillait plusieurs fois par nuit. L’état des coussinets de mon chien empirait également de jour en jour. Cependant, l’effort commun ressouda rapidement l’équipage : P’tit gars et moi retrouvions l’intimité d’une meute à deux. Heureusement que mon équipier était en pleine forme car, moi, j’aurais plutôt eu besoin de vacances pour me remettre de l’hiver. Travailler tous les jours par - 20 °C en pleine nuit boréale m’avait un peu usé.
Au nord-ouest, les sommets enneigés de Norvège nous encourageaient à tirer plus fort et à marcher plus vite. Les sapins avaient progressivement fait place à des bouleaux rabougris sans feuilles, tandis que le paysage s’ouvrait sur une multitude d’étangs, de ruisseaux et de plaques de neige qui miroitaient sous les feux du soleil. Quelques oies ou canards solitaires avaient devancé leurs confrères. Un héron faisait des bonds de cent mètres pour échapper aux crocs de mon chien, car aucune fatigue ne justifiait de passer à proximité d’une proie potentielle sans au moins essayer de la capturer. Je devinais que le busard et le bruant des neiges étaient aussi dans les parages, mais leur immobilité et la couleur de leur plumage les confondaient avec la végétation rase.
En mer de Barents
Là, parmi les fjords du cap Nord, la terre était restée telle que Dieu l’avait forgée à l’aube de sa Création : belle et imposante, dangereuse et sans pitié. Pagayer dans ces lieux reculés était un réel bonheur pour les yeux. Les parois de mille mètres enserrant ces gigantesques bras de mer accentuaient l’impression de profond isolement qui enveloppait ici tout être vivant. De loin en loin, à peine percevait-on le ronronnement d’une barque de pêcheur, néanmoins les fjords étaient si vastes et l’homme si éloigné que l’on demeurait seul. Phoques, marsouins et macareux moine y trouvaient leur compte, vivant comme moi au rythme de la mer. Progressivement, les chutes de neige s’espaçaient pour céder place à de gros tas de flocons fondus ou à un feu nourri de grêlons souvent aussi bref qu’inattendu. Chaque heure réservait ainsi ses instants de surprise, rythmés par la force du vent. Le long des fjords, quelques plages de galets offraient des emplacements de choix pour y installer son campement. Souvent, un lit de végétation d’une diversité étonnante trahissait la présence d’une source ou d’un torrent, et les moules que les marées basses découvraient rendaient possible un séjour prolongé en ces lieux par ailleurs inaccessibles autrement qu’en kayak. La vue sur le cirque enneigé définissant mon horizon rendait alors le site exceptionnel. Vierges d’hommes et revêtues de leur fine robe blanche, les montagnes de cette région nordique s’offraient à l’explorateur des premiers temps que j’avais l’impression d’être, tant l’isolement était parfait, en découvrant avec grâce leurs vallons tout ruisselant de la fonte des neiges encore à ses débuts. Et les difficultés de la mer étaient dans ces conditions largement adoucies. Chaque soir, je m’endormais serein, bercé par mille chants d’oiseaux heureux d’assister comme moi à l’explosion d’une nature qui buvait le soleil 24 heures sur 24.
Unghalak, lui aussi, renaissait après un hiver sombre et glacé, se débarrassant rapidement de l’épais manteau de fourrure argentée qui l’enveloppait et bondissant ça et là comme une gazelle dans l’espoir de retomber de tout son poids sur une souris malheureuse dont il avait flairé la présence. Alors que la fine queue imberbe dépassait encore de ses babines noires, arborant le sourire niais d’un clébard satisfait, il s’allongeait près de moi, l’air innocent pour ne pas avoir à partager sa proie qui de toute façon n’était plus partageable. Toutefois, de sa chasse je n’avais cure si ce n’était le plaisir d’admirer ses impressionnantes envolées ; la véritable curée, elle, nous viendrait des eiders qui sillonnaient l’Arctique depuis peu par compagnies entières et des morues, aussi nombreuses et faciles à pêcher que les brochets du Nord canadien. Vidées, coupées en deux le long de l’épine dorsale et posées sur une pierre plate ou à même la braise, arrosées d’huile d’olive et assaisonnées des bonnes épices (on trouve en Scandinavie un délicieux mélange de citron et de poivre), elles constituaient un mets des plus satisfaisants.
En mer de Norvège
Les fjords de Norvège nous offrirent des eaux relativement sereines. Je devais néanmoins me méfier au passage de certains caps ouverts sur l’océan, véritables cimetières improvisés à rafiots de pêche, où les courants de marée soulevaient une mer hachée au moindre vent. Ailleurs, ces derniers se révélaient faibles, certainement en raison des pertes de charge que le dédale des îles occasionnait.En dehors des goulets et notamment en cas de hauts-fonds, je trouvais souvent des contre-courants salutaires qui permettaient finalement de s’affranchir des horaires capricieux du flux et du reflux. Admirer un soleil qui n’en finissait pas de se coucher était un bonheur quotidien, car ce mois de juin fut exceptionnellement beau. Et chaud ! La transition avec le rude hiver que je venais de passer était brutale.
Pendant des semaines, je dressais le campement à 5 heures du matin et prenais mon petit-déjeuner à 15 heures. Cependant, je ne dormais quasiment plus. Ah ! ce soleil de minuit… une vacherie de la nature ! Un vrai attrape-nigaud pour touristes ! La nuit n’est plus, c’est chouette, ça change, et voici qu’on ne s’arrête plus de pagayer. Ou alors seulement vers 6 heures du matin lorsque l’on se rend compte qu’on a loupé quelque chose, mais quoi ? au bord de la multi-tendino-déchirure généralisée. Donc, bien sûr, on s’installe pour la nuit, je veux dire le jour, en comptant repartir dès la fraîche. Après tout qu’y a-t-il de mal à inverser son emploi de la lumière ? Mais ça, c’est la théorie, car après une ou deux heures de sommeil, le soleil cogne si fort sur le double toit qu’il devient impossible de fermer l’œil, quant à choisir entre la fournaise ou les moustiques… Lorsqu’on a pigé qu’on s’est fait avoir, il est déjà trop tard : on est victime d’insomnie chronique. Il n’y a plus qu’à se contenter de fermer les paupières afin de réhydrater un peu la cornée. Quelle histoire ! Alors, le soleil de minuit, mes amis, vous feriez bien de vous en méfier.
Fin juillet 2001, je me trouvais déjà au sud des Lofoten, cette sarabande de péninsules qui se télescopent jusqu’à cent kilomètres au large des terres, formant le nez crochu si caractéristique au profil de la Norvège. Les côtes de ce pays, qui étaient de loin les plus belles de mon parcours, m’encourageaient dans ma course vers l’horizon. Je tentais chaque jour de rattraper le soleil qui, maintenant, en plongeant quotidiennement de l’autre côté de la mer, prenait sur moi une longueur d’avance. J’installais souvent mes quartiers — tente, kayak, corde à linge et lignes de pêche — sur le flanc oriental d’un îlot, bien à l’abri des bourrasques d’ouest : sable blanc, port naturel, lagon turquoise, havre de paix au cœur de la tourmente que la nature se plaisait à offrir au voyageur pour reconstituer ses forces. Et j’en avais besoin. En soulevant mon kayak pour lui faire faire des rotations de 180° et le monter ainsi tous les soirs jusqu’au bivouac, mon intestin avait fini par sortir de ses gonds en plusieurs endroits : j’avais un début d’hernie abdominale multiple. Je repoussais également mes limites pendant la journée en tirant sans relâche sur les bras. Des rations presque doubles de spaghetti, les morues pêchées, les canards abattus et 250 gr de chocolat par jour m’aidaient à tenir le coup. Ce n’est pas que je me hâtais d’arriver, car non seulement je n’avais nulle part en particulier où arriver, sans compter que je m’éloignais de ce Nord que j’aimais tant, mais l’urgence, il y en avait une évidemment — il y en aurait toujours une — était de presser la vie que je sentais en moi pour en extirper jusqu’à la dernière goutte, avant que je n’eusse plus la force de presser. C’était seule la quantité de ce jus de vie qui avait de la valeur à mes yeux, et pas le temps qu’on passait à faire semblant de presser. Je trouvais amusant comment il était question exactement du contraire dans le monde : presque partout, les hommes cherchaient par tous les moyens à vivre le plus longtemps possible. Contre la pollution et le stress des villes, on inventait des purificateurs d’air d’appartement et de nouvelles thérapies. On appelait ça le progrès de la science. Et on était applaudi. Je préférais de loin la vue panoramique des îlots où je campais : champs de vagues et océans de montagnes qui remuaient dans le vent, ruisselant sous les chaudes lumières vespérales.
Second hivernage (Norvège)
Fin septembre 2001 : deux mendiants campent dans un parc de la banlieue de Bergen. L’un sale, une barbe de terroriste, le ventre creux et l’autre, le poil terne et à l’affût de la moindre souris. Nous survivions alors, il n’y a pas de honte à le dire, de ce que l’on voulait bien nous offrir : pain, fruits, poissons, et surtout espoir.
La suite dans Carnets d'Expé n°5 ! (voir le sommaire ; pour le commander clicker ici)


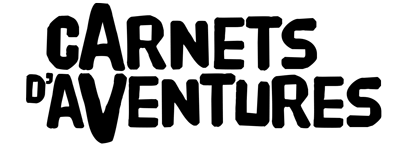


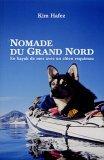





Copier le lien ci-dessus (ctrl+c) et partagez-le où bon vous semble. Ou cliquez sur les liens de partage (fb/twitter)
