Rescapés du Pakistan

Expédition dans le massif de l'Hindu Raj
Texte : Walfroy Constant
Photos : Olivier Pujol sauf mention particulière quand le photographe est Walfroy Constant
Article publié dans Carnets d'Aventures n°8
« À tous les barbus »
Cet article, notre expé, notre sauvetage...
sont dédiés à Barbichu disparu au Népal en octobre 2006
Les billets d’avions sont achetés, nos passeports sont tamponnés du visa touristique de l’«Islamic Republic of Pakistan» et je reçois un mail de notre contact sur place nous informant que la vallée de Charakusa au sud de Baltoro, dans laquelle nous avions prévu d’établir notre camp de base, est occupée depuis peu par l’armée et qu’elle est interdite à tout étranger. Il nous faut trouver un autre massif, libre de droit et d’accès.
Nous entendons parler de l’Hindu Raj près de la frontière afghane. L’accès par le nord est en zone pachtoun mais le sud du massif est une région sunnite dans laquelle nous ne devrions pas connaître de problèmes avec la population. L’Hindu Raj culmine au Koyo Zom à 6872m qui ne semble avoir été gravi qu’une seule fois dans les années 70 et par le versant nord. Nous décidons de faire de ce sommet notre objectif principal et essayons de lui trouver un accès par le sud.
Nous atterrissons à Islamabad le 10 juillet et quittons rapidement cette ville polluée et surpeuplée, dans laquelle règne une atmosphère saturée d’humidité par 45°. Durant les 20h de bus nous menant à Gilgit, nous sommes agréablement surpris par la gentillesse et la convivialité des Pakistanais qui, de toute évidence, ne sont pas tous des tortionnaires à longue barbe enfermant leurs épouses derrière des Burkas. Après avoir acheté la nourriture pour le camp de base, nous quittons Gilgit dans un 4x4 qui nous mène en 7h à Nialthi, terminus de la route par le sud de l’Hindu Raj.
Kerun central face
Nous partons pour 3 jours de marche avec 12 porteurs. À ce moment de l’expé, nous ne sommes encore que 5 : Julien, Olivier, Muriel, Julie et Walfroy. Le Kerun Bar glacier ressemble à celui de Bionnassay : il est recouvert d’une épaisse couche de pierres et s’enroule comme un haricot géant. Nous installons le camp de base à une demi-heure du couloir de neige menant au plateau glaciaire au sud du Koyo Zom, sur les rives du Kerun Bar glacier. C’est vraiment l’engagement dont je rêvais. Nous sommes seuls au fin fond d’une vallée reculée d’un massif quasi inconnu du Pakistan. Personne ne semble y être venu avant nous. Nos cartes sont fausses et je me prends pour Vasco de Gama.
Après 2 jours de camp de base, je remonte ce couloir avec Julien pour établir un camp avancé sur le plateau. Nous partons vers une heure du matin puisque le couloir est plein sud et que les chutes de pierres sont nombreuses dès les premiers rayons de soleil. Nous ne pourrons y circuler que de nuit !
À notre arrivée sur le plateau à 5300, malgré le mal de tête, l’envie de vomir et les épaules meurtries par des sacs trop lourds, c’est l’émerveillement ! C’est comme si nous étions les premiers à nous établir sur le plateau du Géant et à fouler ce monde suspendu. Nous montons la tente avec un minimum de gestes et de paroles superflus. Le lendemain, nous allons gravir le pic le plus à l’ouest du plateau ; au sommet, l’altimètre indique 6001m. C’est la première fois que nous ouvrons un sommet de cette altitude ! Après un retour au camp de base et quelques jours de repos, nous repartons, tous les 5 cette fois-ci, pour le camp avancé.
Lorsque le réveil sonne à 3h au matin du départ pour le Kerun central, la motivation n’est pas au maximum. Il fait très froid et nous avons encore sommeil. Nous décalons le réveil à 5h. À la 2ème sonnerie, Olivier et Muriel ne se sentent pas au mieux ; après une nuit agitée et un mal de tête persistant, ils décident de prendre un jour de plus d’acclimatation à 5300. Julie, Julien et moi partons donc pour le Kerun central qui, selon nos sources, doit culminer à environ 6200m. En retard dès le début de la journée, nous nous enfonçons dans une neige qui commence à ramollir au soleil ; la cadence s’en ressent mais une fois sur l’arête, nous évoluons sur une glace tendre où seules les pointes des crampons s’enfoncent. Le spectacle est exceptionnel et durant 2h, nous vivons un moment de très bel alpinisme. À 2 longueurs du sommet, l’arête devient rocheuse. Je m’y engage sur quelques mètres mais le rocher est aussi friable que de la craie. Les coinceurs et les friends n’y tiennent pas.
Là, nous sommes probablement à la source des erreurs qui nous ont conduits à l’accident. Plutôt que de redescendre, nous faisons le tour par la pente de neige sous le sommet et après 2 longueurs de glace, nous accédons au Kerun central. Après un premier rappel, nous retraversons dans l’autre sens cette pente de neige, mais, pour gagner du temps sur cette journée déjà trop avancée, nous coupons pour aller rejoindre l’arête un peu plus bas. Je pars dans cette traversée avec Julie que j’assure à 3 mètres et confie à Julien la tâche de ravaler la corde de rappel et de nous rejoindre en amenant le reste de corde. Lorsque nous aurons gagné l’arête, nous pourrons l’assurer. À quelques mètres de l’arête, Julie et moi ralentissons car la neige se transforme en glace. Julie se retourne et, ne sachant pas trop les conséquences que pourrait avoir ce qu’elle voit, me dit : « re-regarde, Ju… Julien, il tombe, non ? ». Je me retourne. Effectivement, julien glisse à toute allure sur un tapis de neige. Il descend la pente comme sur une luge. Il a beau essayer d’armer son piolet, toute la neige aux alentours descend avec lui !
À ce moment-là, tout se passe très vite. Il faut bondir de l’autre coté de l’arête, mais nous sommes sur de la glace. Ai-je le temps de l’expliquer à Julie, sera-t-elle capable de faire ces quelques pas hasardeux sur cette pente de glace ? Aura-t-elle l’impulsion suffisante, l’aurai-je ? J’ai juste le temps de refrapper mes piolets dans la glace et, je ne sais par quel mécanisme psychique, au moment où j’ai senti les prémices d’une tension dans la corde, je me suis mis à sourire. La corde se tend et me tire ; je sens alors travailler toute son élasticité. Je la sens s’allonger, je la sens emmagasiner toute la tension qu’elle peut avaler, et, d’un coup, comme si elle n’en pouvait plus de se tendre, elle me catapulte et j’arrache à mon tour Julie sans sentir une once de résistance.
Le premier impact est assez long à venir et à partir de là, nous sommes brassés comme dans les rouleaux d’une vague sur l’Atlantique. J'essaie de repérer Julie dans l’espace, j'essaie de garder à l’esprit où se trouve le haut et où se trouve le bas ; impossible, je ne comprends rien de ce qui m’arrive. Je sens des chocs tantôt sur ma tête, tantôt dans le dos. Pourtant, à un moment donné, ces chocs s’arrêtent et je me sens flotter dans les airs. Je sais exactement où nous sommes : la rimaye ! Nous l’avions contournée le matin même et je sais qu’à cet endroit, elle très haute. Je sais aussi, sans savoir de quel côté il aura lieu, que le choc sera brutal. Je me dis qu’à l’impact, tout va s’éteindre ! Effectivement, le choc à plat dos est brutal et la lumière s’éteint. Pourtant, je perçois encore le mouvement de mon corps qui glisse lentement sur la neige... Le son revient, puis la lumière.
Je cherche les 2 autres du regard et j’aperçois Julien debout se penchant vers Julie. Je la vois raide et désire bondir. Impossible de bouger ; je suis complètement ligoté par la corde qui s’est enroulée autour de moi pendant la chute. Mes crampons pendent à mes chevilles par leurs lanières. Je me désentrave sans pouvoir quitter Julie des yeux. En partie libéré, je me dresse sur mes jambes et retombe aussitôt à genoux comme si je venais d’être poignardé dans le dos ! Je rejoins Julie en marchant à quatre pattes et me penche sur elle en l’appelant comme si elle était à plusieurs kilomètres de là. Elle ne respire plus, elle a les yeux révulsés, du sang sort de sa bouche et son corps est raide comme s’il venait d’être électrisé.
C’est étonnant comme la perception de cette notion d’engagement peut varier suivant le contexte ! Nous sommes toujours seuls au fin fond d’une vallée reculée d’un massif quasi inconnu du Pakistan. Personne ne semble être venu ici avant nous ! L’engagement est toujours aussi fort, mais je ne suis plus Vasco de Gama ! Je ne ressens qu’effroi, impuissance et culpabilité.
Julien n’est pas blessé, la corde l’a fortement ralenti avant la rimaye et il l’a sautée pratiquement sans élan. Nous avons perdu nos gants dans la chute et le sac que nous avions pour nous trois se trouve je ne sais où sur le glacier. La zone où nous nous trouvons va bientôt passer à l’ombre et la température chutera en quelques minutes bien au-dessous de zéro. Julie a toujours les yeux dans le vague et ne peut toujours pas parler. Par contre, elle peut bouger ses jambes. Julien tente de la faire glisser sur les fesses mais la douleur est insoutenable. Il essaie donc de la mettre debout. Ils réussissent à marcher tout doucement. Je suis partiellement soulagé, elle n’a pas la moelle sectionnée. Je les suis à quatre pattes !
Quand Olivier et Muriel nous rejoignent, nous sommes à l’ombre, transis de froid. Prévoyants et en un temps record, ils nous ont monté tout ce qu’ils ont pu trouver de doudoune et de polaires. Julie arrive à marcher avec l’aide de Muriel et d’un bâton, Olivier et Julien me portent sous les aisselles et je fais suivre mes jambes sur lesquelles je ne peux appuyer. Ils nous installent dans nos duvets avec une injection d’antalgique.
Ce même jour, les 3 autres membres de l’expé sont censés arriver au camp de base : Pascal, Barbichu et Nizou. Olivier tente un contact radio après nous avoir couchés : ils sont au camp de base depuis une heure. Ils font leurs sacs et montent nous rejoindre pour nous aider à redescendre le couloir la nuit prochaine.
Julie s’est endormie sous l’effet de l’antalgique. Je place régulièrement mon index sous ses narines pour vérifier qu’elle respire… Quelques heures plus tard, elle se réveille et m’appelle. Elle souffre terriblement et ne sait pas pourquoi :
- « Qu’est-ce qui s’est passé » me demande-t-elle. « Pourquoi j’ai mal ? »
- « Tu ne te souviens pas, on est tombés du Kerun ! »
- « Quand ? »
- « Aujourd’hui !!! »
- « J’ai mal… Pourquoi j’ai si mal ? »
Je suis alors pris d’une angoisse : pourvu qu’elle n’ait pas de traumatisme crânien, une hémorragie cérébrale ou je ne sais quelle saloperie à la tête. J’appelle Olivier pour qu’il lui refasse une piqûre et elle se rendort pour 2 h. La même scène se reproduira encore 2 fois dans la nuit avec à chaque fois les mêmes questions, les mêmes incompréhensions et la même détresse.
Le lendemain matin, après avoir erré dans la face menant au plateau qu’ils n’avaient pas eu le temps de repérer, Pascal, Barbichu et Nizou arrivent au camp. À midi, nous nous rendons à l’évidence : même avec 6 personnes pour nous aider, nous ne pourrons pas descendre ce couloir. Julie ne peut pas se lever ! Olivier, Muriel et Julien descendent le soir au camp de base, Olivier ira chercher du secours. Nous restons donc à 5 au camp avancé dans l’attente, ou plutôt dans l’espoir, d’un hélico car rien ne nous assure qu’Olivier pourra en dégoter un. Julie délire toujours : elle me demande régulièrement où nous sommes, elle m’identifie à un de ses élèves : « Il faut finir la lecture avant de dormir... ». Sur le moment, j’avais du mal à trouver une dimension comique à la situation !
Les jours passent et nous ne savons toujours pas où en est Olivier. L’accident a eu lieu le mardi 25 juillet et le vendredi soir, alors que nous commençons fortement à douter, Barbichu ordonne le silence : « Écoutez ! C’est un hélico ça ? ». Quelques minutes plus tard, 2 hélicos de l’armée pakistanaise tournent au-dessus de nous. L’un des deux se pose manquant d’arracher une tente et Olivier en sort. Je m’effondre en larmes.
En 1 heure, nous sommes transférés à l’hôpital de Gilgit. On nous installe dans une grande chambre où on nous injecte tout un tas de produits dans les veines : vaccins, antalgiques, antibiotiques, tout y passe ! Une multitude de personnes passent nous voir, tous inquiets de savoir si nous avions besoin de quelque chose. C’est un vrai capharnaüm qui a au moins le mérite de rassurer Julie. Par moments, il y a plus de 20 personnes dans cette pièce : il y a la télé locale, le quotidien de Gilgit, l’armée qui vient nous interviewer sur les conditions de notre sauvetage, soucieuse de notre impression sur l’équipement de l’aviation pakistanaise. Il y a même un type de l’Agence France Presse qui, lui, est soucieux de notre approvisionnement en haschich ! On nous apporte un dîner digne d’un mess d’officiers supérieurs. Toute la soirée, c’est un défilé ininterrompu d’infirmiers nous injectant encore je ne sais quoi et de personnes dont je suis incapable d’expliquer la présence dans cette chambre. Le dévouement des Pakistanais à notre égard est démesuré, il y en a même un qui me réveille en pleine nuit pour me proposer une cigarette, que j’ai fumée d’ailleurs !
Cet hôpital serait plutôt un dispensaire. Visiblement construit sous l’époque coloniale, l’établissement est parsemé d’espaces verts mal entretenus. Les peintures s’écaillent et le jardin d’enfants est boueux. Il est presque surprenant de trouver des panneaux indiquant « emergency » ou « surgery » au milieu des allées que les racines des arbres ont rendues complètement impraticables. On se croirait dans un film faisant état de la décolonisation dans le Commonwealth. Nous faisons des radios sur lesquelles on distingue vaguement un squelette humain, elles confirment néanmoins la fracture de la mâchoire de Julie.
Nous n’avons ni passeport, ni papiers, ni argent, rien ! L’hôpital ne fournit pas à manger et Julien, s’il vient, n’arrivera pas avant trois jours. Je m’inquiète auprès du gérant du « snack » de l’hôpital, sur un moyen de pouvoir s’y nourrir à crédit en attendant l’hypothétique arrivée de notre ami Julien. Il en est hors de question ; que Julien vienne où ne vienne pas, il nous offre le thé et le couvert tant que nous serons hospitalisés sur Gilgit ; il portera même à Julie son repas jusqu’à la chambre et s’arrangera pour lui préparer de la nourriture mixée.
Le cousin d’un infirmier qui avait vécu en France vient aussi nous rendre visite et nous propose la même chose que nous ne pouvons décliner. Le chef de la police de Gilgit, vraisemblablement sur demande de l’ambassade, nous faisait livrer tous les soirs un plat chaud. Au final, nous nous retrouvons avec une profusion de plats et de fruits que nous partageons avec les infirmiers et les enfants hospitalisés de l’étage du dessus. Il y a toujours quelqu’un dans notre chambre avec qui nous parlons de Cricket, du coup de boule de Zidane, de la vie au Pakistan, de Ben Laden ou de la politique américaine… Trois jours passent ainsi dans ce microcosme du dispensaire, et nous en oublions presque que nous sommes blessés. Nous avons pris des habitudes, établi des liens, nous nous y sentons bien.
Nous sommes hospitalisés au « Shiffa International Hospital » à Islamabad où les prestations médicales sont comparables à celles d’un hôpital français. On nous diagnostique une vertèbre cervicale fracturée pour Julie et une vertèbre dorsale pour moi ! Nous attendons d’être rapatriés avant toute intervention chirurgicale.
Deux semaines après l’accident, nous sommes en France. On me trouve 4 autres vertèbres fracturées et 3 autres pour Julie qui est opérée d’une ostéosynthèse pour sa 7ème cervicale et d’une fixation de sa fracture de la mâchoire. Je suis bon pour 50 jours d’alitement avec corset et Julie pour 2 mois de minerve. Les médecins nous aident à relativiser : il est déjà miraculeux que nous n’ayons pas atteint la moelle lors de la chute mais il l’est encore plus que nous ne l’ayons pas endommagée lors des 2 semaines de transit avec ces 3 jours sous la tente, l’hélicoptère, le dispensaire, le vol en avion-cargo et le vol Islamabad Londres Paris Toulouse !

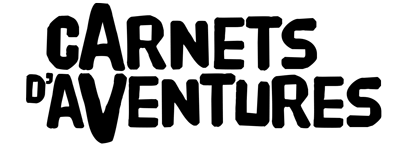





















Copier le lien ci-dessus (ctrl+c) et partagez-le où bon vous semble. Ou cliquez sur les liens de partage (fb/twitter)
